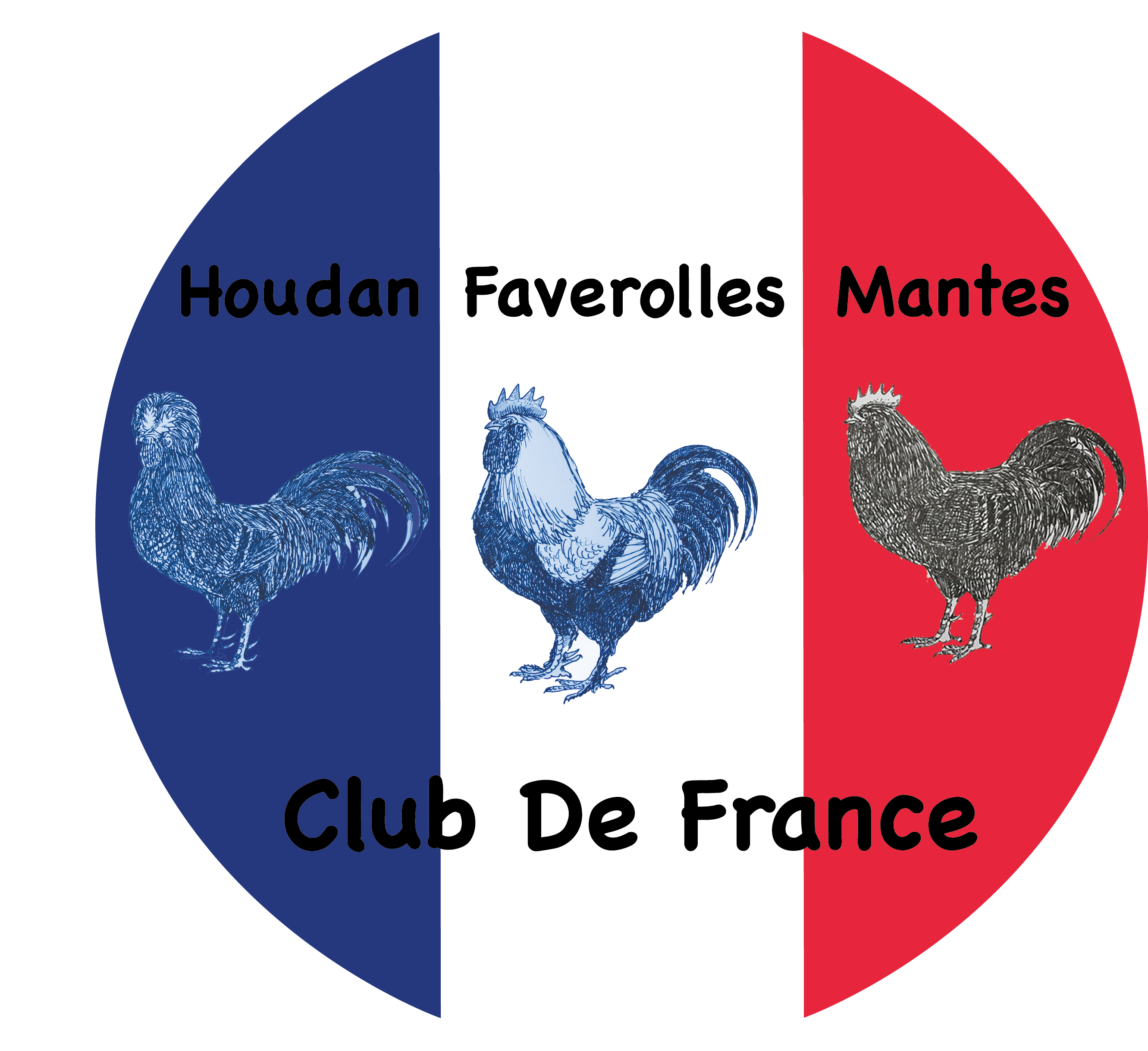
|
HOUDAN
-
FAVEROLLES - MANTES
CLUB DE FRANCE |
La basse-cour productive- les poules de L. BRECHEMIN 1910
Plus que jamais les éleveurs d’oiseaux de basse-cour doivent se tourner vers l’élevage des races à haut rendement, tant pour la production de la chair que pour celle de la ponte ;dans le premier cas, la Faverolles tient évidement la tête, nous publions sur cette race un étude complète ce qui n’avait pas encore était fait à ce jour. Durant de longues années, les amateurs ne voulurent pas l’admettre comme une race, alors que même en Angleterre elle était classée comme tel. A vrai dire il est impossible de lui appliquer le qualificatif de race originale, elle est de toute fabrication et partage d’ailleurs cette situation avec une très grande partie des races classées dans nos concours sans aucune discussion, dont il serait dont il serait un peu long d’énumérer la liste. Nous noterons cependant que parmi toutes nos races françaises, c’est la seule dans laquelle nous constaterons des traces manifeste de croisement. Sélectionnée, perfectionnée, amenée à un point assez régulier de fixité, elle se présente aujourd’hui, dans nos concours, en nombre aussi élevé que les races les plus en vogue et toujours avec des sujets excessivement remarquables qui sont la plus parfaite demonstration de sa haute valeur pratique et la meilleur preuve que le succés peut s’attacher à une race qui n’a eu pour réclame que ses qualités. La poule Faverolles est la première volaille du monde au point de vue de la production industriel du poulet. Ici il n’y a pas eu de discussion possible ; il peut en exister de plus délicates comme chair (dans nos races françaises seulement), de meilleurs comme pondeuses, mais, comme précocité formation rapide du poulet, aucune ne peut lui être comparée. En créant cette variété, c’est le but qu’ont poursuivi les éleveurs de la région de Houdan et ils ont pleinement réussi. Ses qualités, pour la production intensive de la chair, sont reconnues aujourd’hui, tout aussi bien à l’étranger qu’en France. Dans cette belle région de Seine-et-Oise qui comprend toute la région houdanaise, l’élevage du poulet précoce est pratiqué, depuis un temps immémorial, sur une très grande échelle ; c’est lui qui alimente de poulets fins, à l’entrée de la saison, les plus grands restaurants et maisons bourgeoises qui n’hésitent pas à payer les beaux poulets de 8 à 12 francs la pièce. Le marché de Houdan est lui-même un centre important où viennent sur place s’approvisionner les gros clients de Paris, enlevant toute la belle marchandise dés l’ouverture du marché. L’élevage dans la région de Houdan présente même un spectacle tout aussi curieux qu’intéressant. Il n’est pas rare de rencontrer chez un cultivateur une centaine ou deux de poussins qui courent dans la salle où se prennent les repas, la chambre à coucher. Ces poussins éclos dans les couveuses artificielles, sous des dindes, sont livrés au paysans à deux ou trois jours, ils les élèvent ainsi l’hiver, jusqu’au bon moment de les envoyer au marché. Comme ils sont bons pour la vente à une époque où les poulets atteignent un prix très élevé, c’est une excellente opération. Parfois les poulets sont livrés vers deux mois et demi ou trois mois, à des engraisseurs spéciaux ; mais, en général, dans la région houdannaise, on ne pousse pas à l’engraissement à un point aussi excessif que dans la région des poulardes de la Flèche, du Mans, de la bresse. Le poulet, bien en chair, particulièrement bien nourri, est simplement soumis à l’engraissement intensif pendant trois semaines, au moyen de pâtées liquides de farine d’orge et de petit lait que l’on introduit dans le gosier des volailles avec le secours d’entonnoirs, le plus souvent à la gaveuse mécanique. C’est ici que l’engraisseur spécial intervient ; souvent le poulet est envoyé au marché simplement affiné durant une dizaine de jours. L’élevage dans la région houdannaise, constitue donc une véritable industrie de la volaille pratiqué de père en fils, où la division du travail se présente la plus part du temps, en accouveurs, éleveurs et engraisseurs. On ne sera donc pas surpris que cette industrie ai poursuivi la création, la sélection d’une race de volailles pouvant donner le plus gros produit dans le minimum de temps ; de ce point de vue pratique est née la Faverolles. Sans doute la région possédait une race de vieille réputation, de développement rapide, de chair exquise, mais cependant, si rapide que fut la croissance, elle n’était pas suffisante pour un véritable poulet industriel, puis la race de Houdan, très consanguine, était parfois un peu délicate à élever , Cependant en raison de ses qualités si hautement appréciées, c’est elle qui devait intervenir comme facteur principale d’amélioration. On la croisa avec diverses races d’origine asiatique, particulièrement avec la Brahma ; la race anglaise Dorking intervint aussi heureusement. De ces mélanges divers sortirent des types extrêmement bariolés qui déroutèrent un peu les amateurs dans les concours car les nouveaux venus étaient présentés comme Houdan, tout en en possédant guère le type. Bientôt, la distinction obligé se fit. La Houdan, défendu par quelques bons amateurs et éleveurs,fut d’une part conservée dans son type bien pur et sa dérivée reçue le nom d’une localité où se pratiqué en grand son élevage : la Faverolles était baptisée. Elle paru bientôt sous ce nom, dans les concours de l’état, non sans soulever de violentes réclamations d’où la jalousie n’était nullement exclue, bien au contraire. A vrai dire, elle portait assez facilement à la critique. Au point de vue pratique, presque du premier coup, les éleveurs avaient atteint le but qu’ils cherchaient : un poulet iminement rustique se développant avec une rapidité inouïe, excellente de chair, prenant facilement la graisse, peut-être un peut moins fin que la Houdan, mais infiniment supérieur d’un point de vue commercial. Les types étaient extrêmement bariolés, mais la plus part conservaient la cravate et les favoris, la patte blanc rose, les cinq doigt de la race mère, ce qui permettait aux marchands d’affirmer : » vous voyez bien que c’est de la Houdan, elle à cinq doigts ». Tout ce qui se vend au marché de Paris, sous le nom de Houdan,n’est, en effet, que du Faverolles ; c’est une Houdan modifiée voila tout, le public ne peut se considérer comme trompé. Si cette variété de type ne présentait aucun inconvénient pour l’élevage, au point de vue classement il n’en était pas de même ; devant cet assemblage hétéroclite, les juges se trouvait un peu déroutés. Voici les types tels que les décrivait un des propagateurs et défenseurs de la Faverolles, mon excellent ami M. Roulier-Arnoult. 1° Une poule massive ayant les mêmes allures que la race asiatique de Brahma, mais le plumage plus ou moins clairet liseré de noir ; 2° Une poule de même apparence que la Cochinchinoise, un corps penché en avant plumage de teinte chamois ou fauve avec un mélange de plumes blanches ou liseré de blanc ; 3° Une poule de genre Dorking, aussi volumineuse que les précédentes, mais d’allure plus légères, c’est une Dorking rougeâtre, même dessin presque que dans la race pure ; 4° Une poule genre Houdan, avec moins de volume que dans la race type, le cailloutage noir et blanc manque de régularité, la huppe n’existe pas, cette variété est une des moins répandue ; 5° Une poule qui présente assez le plumage de la race coucou de Rennes, avec des nuances tantôt claires, tantôt foncées. Enfin, il convient de citer encore de grosses poules noires présentant des allures lourdes, massives de la race asiatique de Langshan. Voila pour les poules. Parmi les coqs, les types dominants se rapprochent des races Brahma, Dorking et coucou, mais toutes ces variétés, coqs comme poules, ne se rapportent au type cités que par des caractères généraux. Dans un même genre, il y a des différences de crêtes, de pattes, de régularités de plumage, qui établisse que les éleveurs n’ont jamais eu la préoccupation de rechercher les qualités d’uniformité que l’on exige dans les races pures ; leur seul but, on le sait, a été de produire des volaille d’une ampleur peu commune et d’un développement très rapide. Les éleveurs de la région se sont alors demandé s’il ne serait pas possible de sortir de ce chaos, d’unifier ses types si divers, tout en leur conservant les qualités essentielles de précocité et de vigueur si parfaitement atteintes par la race ; il y eut des opposants, je ne dois pas cacher même que je fus du nombre. Ma crainte partagée par plusieurs amis bien sincères, était de voir amoindrir ces hautes qualités que l’on était loin d’avoir obtenu du premier coup. Tout d’abord la sélection se porta sur une variété blanche à camail herminé, rappelant beaucoup l’origine de la Brahma ; la demande de ce type ayant été très abondante dans la région houdannaise, on eut bientôt beaucoup de mal à en trouver suffisamment pour la satisfaire. N’allez pas croire que les éleveurs furent embarrassés pour si peu, ne pouvant plus fournir ce type, on en décréta comme étant le seul vrai et le plus joli ; il s’est d’ailleurs imposé de telle manière que c’est encore aujourd’hui le seul admis. Elevé en quantités considérables, dans des région assez diverses, le type ne c’est nullement abâtardi, bien au contraire, il s’est améliorer. Le coq rappelle beaucoup, comme dessin de plumage, celui de Dorking, mais la forme est beaucoup plus enlevé, genre coq Houdan ; la tête est encadrée de favoris et d’une cravate qui affirme encore la parenté avec cette dernière et excellente race, le plus souvent la patte possède les cinq doigts de la Houdan, mais ce n’est pas un caractère essentiel.. Quand à la poule sa forme et son volume sont ceux d’une très grosse Houdan, très cravatée aussi, largement pourvu de favoris, reproduisant, , en réduction, la très belle crête haute et droite du coq, la poule en diffère totalement comme plumage ; elle a emprunté à la Dorking la teinte saumonée de son poitrail, le fond du plumage est généralement blanc, ces teinte saumonées se répartissant avec plus ou moins d’abondance sur tout le corps et avec diverses intensité de nuances atteignant jusqu’au brun assez foncé sur les plumes du cou ou du camail et de la queue. Il est parfaitement admis de ne montrer aucune exigence en ce qui concerne la nuance plus ou moins saumonée du plumage, de même pour le coq, que l’on préfère avec un beau poitrail bien noir ainsi que la queue, mais si l’oiseau est très ample, bien fait, on lui passera parfaitement des plumes blanches ou grise se glissant intempestivement dans ce noir d’ébène, de même des rayures noires dans le camail plus ou moins argenté sont parfaitement supportées. Grâce a cette intelligente pratique de ne pas s’asservir à un type rigoureusement absolu, comme on est forcé de le faire pour une race de sport, les éleveur de la race de Faverolles, évitant la consanguinité, ont pu maintenir à leur création toutes les hautes qualités qui ont si justement affirmé sa grande réputation. A ce propos, il est encore un caractère qu’il n’est pas inutile de faire mention ; ce sont les plumes aux pattes, caractéristique des races asiatiques et particulièrement de la race Brahma, ancêtre si proche de la création de la race Faverolles ; ces plumes aux pattes, jadis caractère bien plus spécial, sont considérées aujourd’hui comme sans importance, on préfère même les sujets qui n’en sont pas trop abondamment pourvus, et l’on admet aussi ceux qui en manque complètement. Nous avons tenu à donner tous ces détails non seulement pour guider les amateurs qui voudraient présenter cette race dans les concours, mais aussi parce qu’ils donnent une idées bien précise du but poursuivi par les créateurs de la race : nous allons maintenant d’après nos observations et les documents publiés par le Houdan-Faverolles-Club, citer les caractères monographiques de la race : Le coq. – Tête longue et forte ; bec fort, assez long, légèrement recourbé de nuance corne, parfois gris jaunâtre ; crête simple, droite, bien régulièrement dentelée, de hauteur variable, un crête un peu haute, sans exagération sera toujours préférable pour un coq volumineux ; on la recherchera fine de grain, indice de chair délicate ; huppe : aucune trace de huppe ou d’épi ne doit déceler le croisement houdan ; œil grand, bien dégagé, iris roux clair ou gris, bien vif ; oreillon peu développé, rosé ; barbillons de moyenne longueur, assez large, de tissu fin, d’un rouge bien vif comme la crête ; face presque complètement envahie par les favoris, on n’en aperçoit que la partie située derrière la mandibule supérieure ; favoris bien fournis sans excès ; cravate de même que les favoris biens fournie descendant un peu plus bas, se confondant avec eux, si bien qu’elle parait former un même collier de plumes se rejoignant d’un œil à l’autre. Cou fort, vigoureux, garni d’un abondant camail qui augmente encore l’aspect, couvrant le dos à la naissance ; dos très large s’inclinant légèrement vers les reins, également larges et vigoureux et recouverts par les lancettes assez abondantes et de longueur moyenne ; épaules vigoureuses où s’attachent les ailes très fortes, saillantes, carrées au départ, courtes, plaquées au corps en allant vers la pointe qui disparaît sous les plumes des lancettes ; poitrine ample, bien pleine, légèrement proéminente quand le coq se tient bien droit ; queue peu volumineuse, grandes faucilles bien arrondies dépassant à peine les plumes inférieures qu’elles recouvrent ; cuisses et jambes longues et fortes disparaissant presque complètement dans la masse abondante du plumages ; tarses assez longs, blancs ou rosés, légèrement garnis de plumes, parfois complètement nus ; doigts : quatre ou cinq doigts, longs et forts, de même nuance que les tarses ; taille : la plus élevée possible, l’ampleur et le volume étant une des qualités primordiales ; poids, de même que pour la taille, les poids les plus élevés sont les plus recherchés, un coq adulte ne devrait pas peser moins de quatre kilogs. La description du plumage laisse à l’éleveur une certaine latitude ; les plumes du camail peuvent être blanc d’argent, blanc –gris, blanc-crème, rayées ou non de noir. Les plumes des reins ou lancettes ont toujours les mêmes nuances que celles du camail ; le poitrail peut être noir de de jais, noir-gris ; dos et épaules : des nuances blanc-crème, gris clair, gris foncé, et noires peuvent y être admises, ainsi que sur les ailes. Si toutes ces nuances sont admises, elles doivent toujours être réparties avec assez d’égalité pour ne pas former un ensemble brouillé disparate ; queue noire à reflets métalliques verts, quelques plumes blanches peuvent s’y rencontrer, les éviter si possible. Physionomie générale : le coq Faverolles doit avant tout donner une impression de force, d’ampleur, de vigueur ; volumineux sans lourdeur, les jambes biens dégagées et très d’aplomb, l’air fier et l’allure vive, un équilibre parfait des formes, tels sont les caractères qui doivent appeler tout d’abord l’attention du juge et de l’amateur, les détails du plumage, tout en n’étant nullement négligeables, viennent ensuite. Une mauvaise crête, une queue mal faite, de travers, sont des défauts inadmissibles ainsi que des pattes ou la chair jaunes. La cravate et les favoris caractérisant bien la physionomie de l’oiseau ont aussi beaucoup d’importance. Rejeter aussi le brun dans le plumage. La Poule. – Très différente du coq comme plumage, la poule n’affirme son étroite parenté que par la conformation de la tête où se représentent la cravate et les favoris si caractéristiques. La tête est fine, relativement au volume du corps, elle paraît même petite ; crête, oreillons, barbillons comme chez le coq ; mais en réduction ; bec, œil de même que chez le coq ; cravate garni d’un camail abondant, bouffant légèrement sur la nuque, au départ, où il forme même souvent un pli assez accentué ; dos et reins longs et larges formant une ligne bien horizontale ; ailes courtes, vigoureuses, portées un peu hautes et bien serrées au corps ; poitrine ample, arrondie, descendant brusquement vers l’abdomen. Le bréchet : long, plus encore que celui du coq, permet le développement abondant des pectoraux ; queue assez courte, bien garnie, portée légèrement relevée et très étalée, presque en éventail ; cuisses et jambes très fortes, plutôt courtes disparaissent dans la masse des plumes ; tarses moyens, plus ou moins garnis de plumes, blanc ou rosés ; doigts assez forts, quatre ou cinq, de même nuance que les tarses ; taille relativement élevée, mais le volume réside beaucoup dans la longueur du corps, les sujets les plus volumineux sont les plus appréciés ; la poule adulte doit atteindre le poids de 3 kil. 500. La teinte générale du plumage, sur un fond blanc ou blanc crème, est un saumoné plus ou moins foncé ; sur le dos, les épaules, la naissance des ailes, la nuance est toujours plus accentuée ; les grandes plumes du vol, ainsi que l’extrémité de la queue, sont mêmes franchement brunes ; les plumes du camail sont le plus souvent de cette même nuance de brun, plus ou moins foncé, parfois rayées de noir au centre de chaque plume. Suivant les parties du corps, du saumon clair au saumon foncé, comme du brun clair au brun foncé, toutes les nuances sont admises, elles doivent simplement être réparties bien également ; jamais de bariolage. Physionomie générale : L’apparence générale de la poule Faverolles doit donner l’impression d’un oiseau très volumineux, un peu massif, mais sans lourdeur, la démarche est calme, sans lenteur. C’est une poule essentiellement tranquille, souvent familière. Les formes, soit dans le type un peu long, soit dans le type plus ramassé, doivent toujours être bien arrondies, pas de bouffant, pas de heurté dans les cuisses, comme dans les races de Brahma ou Cochinchinoises. Les qualités morales de la poule sont fort intéressantes. C’est une pondeuse très précoces ; des poulettes nées en avril et même en mai commenceront leur ponte à la fin de l’automne pour la continuer tout l’hiver ; naturellement, ces premiers œufs sont un au-dessous de la moyenne au début. La race n’est d’ailleurs pas réputée comme forte pondeuse, elle a été spécialement créée pour fabriquer du poulet précoce. Elle est bonne couveuse, élève fort bien ses poussins. Toutes ces qualités assurent à la poule de Faverolles une place particulièrement intéressante dans la basse-cour du fermier comme dans celle de l’amateur. Le poussin de Faverolles mérite une mention toute particulière ; de tous, c’est celui qui se développe le mieux et le plus vite. Les ailes, ne lui poussant pas trop rapidement de l’épuisent pas les premier jours, comme dans beaucoup de races ; il se développe avec une rapidité hors pair, quand il reçoit des soins bien appropriés. Dans la région de Houdan, on l’alimente particulièrement avec de la farine d’orge et du lait ; j’ai montré dans mon livre (Poules) combien on obtenait des résultats très supérieurs, comme rapidité de croissance, avec une alimentation animalisée dans les mois de croissance. Ce n’est pas le lieu d’exposer cette méthode, il suffit de noter la méthode houdannaise qui donne aussi de bons résultats puisque les poulets sont en état d’être mis à l’engraissement au bout de treize semaines. S’il s’agit tout simplement d’affiner les poulets, d’en faire des demi-gras, l’engraissement ne dure qu’une dizaine de jours, il dure vingt et un jours lorsque le but est de produire du fin gras. Cette croissance et cet engraissement rapides, permettent à l’éleveur de renouveler rapidement son capital, ce qui est un principe essentiel de bonne gestion commerciale. Voici, au surplus, bien exactement comment l’élevage se pratique dans la région de Houdan. Le poulet qui ,dès son jeune age, est habitué à manger à discrétion, grossit beaucoup plus vite et gagne une prédisposition à l’engraissement, grand avantage à l’époque où on lui applique ce régime. Les premiers jours on donne quelques repas avec des œufs dur ou mollets, du pain émietté et un peu de verdure mais l’alimentation principale est composée d’une pâtée ferme de farine d’orge ou du mais délayée avec de l’eau, du petit lait ou du lait coupé de 50/100 d’eau ; il faut toujours se rapprocher du lait. Pour faire une pâtée assez ferme sans être dure, on ajoute un litre de liquide pour un kilogramme de farine, on y ajoute généralement , pour la rendre plus appéttissante, environ cent gramme de riz cuit, dit riz à veaux.. De la verdure et des oignons hachés sont encore souvent ajouté à cette pâtée qui est distribué aux poussins jusqu'à ce qu’ils aient atteints six semaines. Les poussins ont le plus de parcours possible, les petits insectes, verdures fraîches , graviers, etc., etc., qu’ils trouvent en courant de coté et d’autres, leur complètent la vigueur qui résulte d’une bonne alimentation. Pour l’élevage d’hiver, alors qu’ils sont maintenus dans un chambre spéciale, on leur jette sur le sol des grains de millet et, si on le peut, des petits vers qu’ils se volent les aux autres, ce qui leur procure un exercice salutaire. A six semaines, les poulets peuvent recevoir une nourriture un peu moins délicate, le riz et le millet sont souvent remplacés par du petit blé, de l’avoine du sarrasin. La pâtée est faite un peu moins épaisse , on y mélange des pommes de terre soigneusement écrasées, la farine dominant toujours et le liquide se rapprochant le plus du lait. Les poulets, élevés à ce régime, pèseront 1 kilo 500 à trois mois et demi. Ils sont d’une vente facile, tels quels, mais les éleveurs trouvent avantage à leur faire subir un demi engraissement de dix jours ou l’engraissement de trois semaines qui en augmente sensiblement la valeur. Cet engraissement se pratique soit à l’entonnoir, soit au moyen de gaveuses mécaniques. Trois fois par jour on gave les élèves avec une pâtée très liquide composé de lait ou de petit lait et de farine d’orge et de mais bien blutée, on emploie environ 300 à 500 grammes de farine par litre de liquide. Les bêtes enfermées, par dix, dans une cage ou épinette, sont saisies les unes après les autres et soumises au régime indiqué ci-dessus ; on leur introduit l’entonnoir dans le bec, ayant auprès de soi un baquet rempli de pâtée liquide que l’on saisit au moyen d’une louche. Avec un peu d’habitude c’est l’affaire de quelques minutes par bête. A ce régime, les volailles doivent gagner en trois semaines de 750 grammes à un kilo. Certains éleveurs, les trois derniers jours de l’engraissement, ajoutent dix grammes de graisse de porc fondue avec le lait et un œuf cru par litre de pâtée. La variétés de Faverolles est très rustique, s’accommodant de tous les climats, toutefois il ne faut pas, sous pretexe que l’on possède des sujets de premier ordre, éviter de toujours les améliorer en conservant, pour la reproduction, les sujets qui se seront développer le plus rapidement ; ne faire couver aussi, dans ce but spécial, que des œufs des poules ayant commencé leur deuxième années de ponte ; au bout de quelques années se procurer un beau coq de bonnes origine, pour changer le sang. On conservera ainsi à cette belle création avicole toutes les hautes qualités industrielles qui justifient si amplement sa haute réputation. |
|